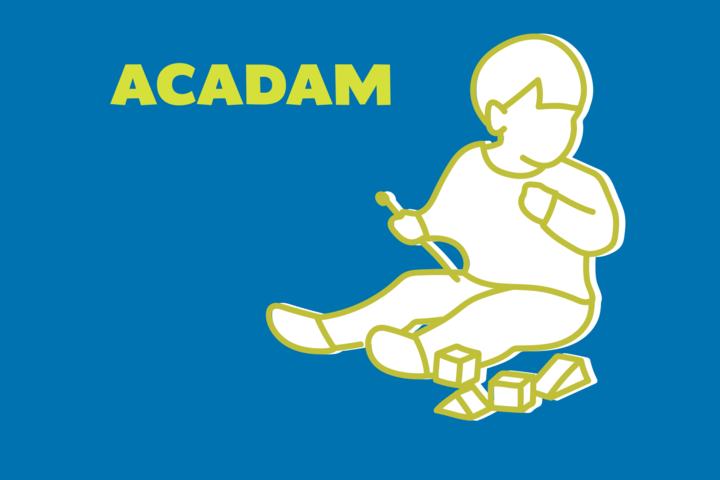Le lundi 4 mars, à Versailles, le Congrès réunissant l’ensemble des parlementaires a adopté une révision constitutionnelle visant à intégrer la « liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse (IVG) ». Elle a été promulguée le 8 mars 2024 par le Président de la République.
Presque 50 ans après l’autorisation de l’IVG en France grâce à la loi Veil, les mobilisations féministes ont réussi à obtenir son inscription dans la constitution. Enfin, au terme de plusieurs années de luttes féministes face aux menaces qui pesaient sur le droit à l’IVG, la constitution va devenir un appui considérable pour le défendre. Enfin, la possibilité des femmes à recourir à l’IVG est consacrée dans la loi fondamentale de notre pays, et aucune législation ne pourra, désormais, s’opposer explicitement à l’accès à l’IVG.
C’est une victoire historique pour les droits des femmes en France et un message d’espoir fort envoyé aux femmes du monde entier. À travers le monde, 40% des femmes vivent dans des pays où l’accès à l’IVG est restreint voir illégal. L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’au moins 39 000 femmes meurent chaque année à cause d’avortement non-sécurisés. En France, des mouvements d’extrême-droite et autres intégristes dont il ne faut pas sous-estimer l’influence continuent de menacer l’accès à l’IVG. Par exemple, il existe plusieurs sites internet de désinformation sur l’IVG qui cherchent à dissuader les femmes souhaitant y avoir recours ; des militants anti-IVG vont jusqu’à pénétrer dans des lieux où il est pratiqué pour intimider soignant·es et patientes ; le 25 février, la chaine CNews appartenant au groupe Bolloré assimilait l’avortement à la plus grande « cause de mortalité » dans le monde. Face à ces attaques, nous savons qu’il existe maintenant une digue constitutionnelle sur laquelle s’appuyer pour défendre le droit des femmes à disposer de leur corps.
Besoin d’un véritable « droit » à l’IVG.
Néanmoins, cette victoire historique et symbolique ne signifie pas une pleine effectivité du droit à l’IVG en France. D’abord, parce que le texte adopté le 4 mars ne mentionne pas un « droit » mais une « liberté garantie ». Ce qui est inscrit dans la constitution c’est donc comme dit plus tôt, l’interdiction pour l’Etat ou la loi d’en empêcher l’accès. En revanche, le texte ne dit rien sur les conditions dans lesquelles cette liberté doit s’exercer et il est flou sur les conditions d’accès à l’IVG ou même sur la question du remboursement par la sécurité sociale. Cela veut dire que si une loi visait par exemple à appliquer un déremboursement de l’IVG, c’est le Conseil constitutionnel qui trancherait.
Aujourd’hui, qu’en est-il de l’accès à l’IVG en France ? Malgré l’autorisation à avoir recours à l’IVG, il existe de nombreuses limites à l’effectivité de ce droit dans la réalité. Depuis plusieurs années, le planning familial alerte sur le manque de moyens déployés sur le territoire pour permettre aux femmes d’accéder à l’avortement. Toujours selon lui, 130 centres d’IVG ont été fermé durant les 15 dernières années tandis que d’autres seraient toujours menacés faute de moyen. À ce problème s’ajoute le manque criant de praticien·nes : seulement 2.9% des généralistes et gynécologues et 3.5% des sages-femmes procèdent actuellement à des IVG. Nombreux sont celles et ceux qui refusent de la pratiquer en vertu de la clause de conscience. Ce manque de moyens garantir le droit à l’avortement touchent d’ailleurs particulièrement notre département puisque selon la Drees, en 2022, 40% des femmes résidant dans le Val-de-Marne qui y ont eu recours l’ont fait dans un autre département.
La liberté constitutionnelle est une étape franchie par la France mais il faut aller plus loin et l’inscrire comme un véritable droit constitutionnel que l’Etat doit garantir. Il faut donc plus d’investissement public dans le système de santé, dans l’hôpital public et pour le planning familial pour que partout sur le territoire, les femmes puissent s’informer et recourir librement à l’IVG quand elle le souhaite. Les collectivités peuvent aussi accompagner l’application de ce droit avec les politiques locales à conditions qu’on leur en donne les moyens.